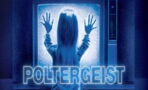En 1988, à l’université de Berkeley, deux chercheurs en psychologie — James Gross et Robert Levenson — se sont penchés sur une question peu banale. Quels films sont capables de faire ressentir une émotion bien précise ? Pas pour alimenter des débats de cinéphiles, mais pour concevoir un véritable outil scientifique — étudier le cerveau, le comportement, ou même certaines pathologies liées aux émotions.
Alors ils ont épluché des dizaines de recommandations venues de critiques, de collègues… et même d’employés de vidéoclubs. Oui, les vidéoclubs. Si ça vous dit quelque chose, vous faites partie du club très fermé des anciens qui ont rendu des VHS en retard au moins une fois dans leur vie.
En 1995, ils passent à l’étape suivante. 76 extraits soigneusement choisis, projetés à 500 étudiants. Chaque scène vise à faire naître une émotion bien distincte : amusement, colère, contentement, dégoût, peur, tristesse ou surprise. À chaque visionnage, les étudiants notent ce qu’ils ressentent. Ce qui ne devait être qu’un outil de laboratoire devient finalement une référence. Et dans la catégorie tristesse, un film sort du lot.
Une scène, trois minutes, un cœur en miettes
Le film s’appelle Le Champion. Un remake sorti en 1979, signé Franco Zeffirelli. Il raconte l’histoire de Billy Flynn, un ancien champion de boxe au bord du gouffre, qui tente de se reconstruire pour son fils. Le pitch semble classique. Mais c’est la dernière scène qui bouleverse tout.
Après un combat héroïque, Billy remporte la victoire. Il redevient “le champion”, sous les yeux de son fils. Mais dans les coulisses, son corps lâche. Il meurt dans les bras de l’enfant. Ce dernier, incarné par Ricky Schroder (9 ans à l’époque), se met à pleurer. Pas une larme discrète. Un effondrement total, brut, incontrôlable. Une détresse si authentique qu’elle traverse l’écran.
Selon les chercheurs, c’est “l’essence même de la perte irréversible, condensée en quelques minutes”. Depuis, cette scène a été utilisée dans plus de 300 études. Elle est citée plus de 4 000 fois dans des publications scientifiques. Elle est devenue l’étalon officiel de la tristesse filmée.
- Ceci peut vous intéresser : voici les 10 films les plus drôles de tous les temps, selon une étude
Ce que la science retient du cinéma
L’étude de Gross et Levenson ne s’est pas arrêtée là. Elle a aussi identifié d’autres extraits aux effets émotionnels marquants :
- Amusement : un sketch de Robin Williams sur scène, suivi de la scène culte du restaurant dans Quand Harry rencontre Sally.
- Peur : le duel final dans le Le Silence des agneaux, légèrement devant The Shining.
- Dégoût : Pink Flamingos (rien d’étonnant) et une scène d’amputation. Peut-être que Terrifier pourrait avoir sa place en 2025.
- Surprise : des thrillers des années 80 comme Capricorn One ou Mélodie pour un meurtre.
- Colère : Veux-tu être mon garde du corps ? et Cry Freedom.
Mais aucune de ces émotions n’a marqué les esprits comme le chagrin laissé par The Champ. Alors si vous cherchez un film qui touche juste, qui ne triche pas avec les émotions, vous savez maintenant lequel.
Mais attention, ce classement repose sur une étude vieille de 30 ans. Depuis, le cinéma a changé, le public aussi. Ce qui nous bouleversait hier ne nous touche plus forcément aujourd’hui de la même manière. Une version 2025 de cette expérience pourrait bien rebattre les cartes.
Sources utilisées :
Emotion Elicitation Using Films
The acute effects of inhibiting negative and positive emotion